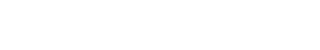La traversée du Pakistan en auto-stop
LA TRAVERSÉE DU PAKISTAN EN AUTO-STOP
Admirer des camions incroyablement décorés, rencontrer les patrons de la mafia pakistanaise… Entre désespoir et euphorie, Morten Hübbe et Rochssare Neromand-Soma traversent le Pakistan en auto-stop.
En 2011, Morten et Rochssare sont partis vivre sur le continent sud-américain. Pendant deux ans, ils ont voyagé entre la Terre de Feu et les Caraïbes, se déplaçant en auto-stop et se logeant grâce au couchsurfing.
Depuis 2014, les deux auto-stoppeurs allemands visitent l’Inde et maintenant l’Asie du Sud-Est. Dans cette nouvelle story, ils retracent leur aventure entre L’Iran et l’Inde en passant par le Pakistan…
De grosses gouttes de sueur commencent à perler sur mon front, rejoignant mes sourcils puis se frayant un chemin le long de mes tempes. Alors que nous traversons la frontière entre l’Iran et le Pakistan, nous sommes déjà plongés dans le vif du sujet. Autour de nous, une violente tempête fait rage. Des petits grains de sable viennent nous fouetter à travers nos vêtements. Impossible de se défendre. Le sable est trop fin et pénètre à travers chaque petite ouverture, craquant entre nos dents, rendant notre respiration difficile. Nous sommes au milieu du Baloutchistan, une région marquée par les combats, la rébellion, l’indépendance et le terrorisme depuis des décennies. Difficile de se sentir en sécurité ici…
WILD WEST BALOUTCHISTAN
Nous entrons dans une zone terroriste – tout du moins, c’est ce que nous raconte l’un des passagers. Malgré ça, les autorités frontalières pakistanaises nous paraissent particulièrement détendues. Et pourtant, c’est un fait, nous risquons à tout moment d’être enlevés ici. Après avoir présenté nos papiers, nous sommes envoyés au poste de police de la ville frontalière de Taftan, à 500 mètres de là. Personne ne nous accompagne, personne ne se soucie de notre sécurité.
Nous nous sentons franchement seuls.

TAFTAN DANS L’OBSCURITÉ
Au poste de police, nous sommes accueillis dans le noir total. Taftan, connectée au réseau électrique iranien, a été paralysée par la tempête de sable qui a renversé sur son passage plusieurs pylônes électriques. Seuls, nous décidons de passer par le fenêtre entre-ouverte et, peu à peu, nos yeux s’habituent à la faible lueur du bureau du commandant de service. L’épais registre dans lequel nous nous enregistrons est recouvert de sable fin, tout comme le reste de la pièce.

Aujourd’hui, il ne se passe grand-chose. L’escorte, obligatoire pour tout voyageur souhaitant traverser le Baloutchistan, n’est pas disponible. Nous passons donc le reste de la journée au poste de police.
La panne de courant ne nous arrange vraiment pas. Le réseau informatique de la seule banque de la ville est hors service. Nous n’avons pas d’argent pour l’hébergement ni même pour manger quoi que ce soit. Au lieu de cela, nous passons la nuit à la lueur d’une bougie dans un bureau de police, et dînons avec le commandant. Ce dernier s’efforce de nous rassurer. Avec son drôle d’accent pakistanais, il nous parle de son pays. Oui, nous sommes au Pakistan. Non, le foulard n’est plus nécessaire ici, contrairement à l’Iran.
Oui, il y a déjà eu des enlèvements et des attaques meurtrières au Baloutchistan. Non, nous ne devons pas nous inquiéter – ce soir nous pouvons dormir ici tranquillement. Nous sommes en sécurité.
Dehors, dans la cour du poste de police, quelques hommes – policiers et villageois – se rassemblent. Des conversations vives brisent le silence et, de temps en temps, des rires venant du cœur parviennent à nos oreilles.
LA ROUTE CONTINUE : AVEC LES GARDES ARMÉS DU BALOUTCHISTAN
Le lendemain, nous montons à bord d’un 4×4 rouillé – le premier du convoi de véhicules militaires et voitures de police qui traverse le Baloutchistan. Nous sommes escortés par trois gardes armés : des membres d’une unité paramilitaire composée de conscrits indigènes, d’officiers, de soldats et de policiers. Seuls quelques kilomètres nous séparent ici du territoire des talibans en Afghanistan. Les gardes armés patrouillent le long de la seule route pavée, les yeux constamment rivés sur le désert et tout ce qui s’y meut.
Nos trois gardes sont dans le métier depuis longtemps. On le voit à la peau patinée de leurs visages, à leurs yeux ressemblant à de profondes cavernes et à leur apparence toute entière qui reflète parfaitement la difficulté de la vie dans le plus grand État du Pakistan.
Depuis la fondation du Pakistan en 1947, les conflits au Baloutchistan se sont intensifiés à plusieurs reprises. Bien que la région s’oppose depuis toujours à une fusion avec le nouvel État, l’armée pakistanaise l’annexa en 1948. Les émeutes et les affrontements violents entre séparatistes et militaires font désormais partie de la vie quotidienne de la province la plus pauvre et la plus sous-développée du pays.

LES 600 PREMIERS KILOMÈTRES : UN VRAI PARCOURS DU COMBATTANT
Les nombreux trous qui criblent la route sont parfois si profonds que notre véhicule se met à sauter de plus en plus violemment. Le véhicule est trop petit pour nous et nos compagnons, et surtout pour nous et l’un des gardes qui voyageons dans la benne et sommes d’autant plus exposés aux nombreux chocs.
Pendant une heure, nous voyageons à travers la nature sauvage du Baloutchistan jusqu’à ce que nous nous arrêtions dans une petite cabane. Au milieu de nulle part, entourés de sable, de poussière et de vent, de petites huttes, des cabanes et des abris se succèdent sur le bord de la route. Partout la même configuration : une chambre, un petit lit, une chaise, une grosse mitraillette et un épais registre. De là, la route est surveillée pour tout le reste du Baloutchistan. Un garde, puis un autre, et chaque fois nous devons montrer nos passeports et signer les registres. Notre voyage est documenté avec une incroyable précision. Lors de ces vérifications, nous changeons régulièrement de véhicule, de sorte qu’au fil du temps, nous apprenons à connaître de plus en plus de gardes.
Les gardes sont des soldats de profession, mais pas des soldats professionnels à proprement parler. Au lieu de porter un uniforme, ils portent leur shalwar kamiz, les vêtements traditionnels du Baloutchistan. Un pantalon large et un haut à manches longues qui atteint les genoux. Ils se protègent du vent et du sable avec des couvertures et des serviettes enveloppant leur tête et leur corps.

Quand le vent finit par disparaître, s’offre enfin à nous une superbe vue dégagée sur le désert. Le sable et la pierre grise s’étendent jusqu’à l’horizon, où un ciel sombre et chargé de nuages offre un contraste saisissant. Parfois, d’énormes tas de sable bloquent notre route, que nous évitons en zigzaguant. Quelques dromadaires se baladent à quelques mètres de la route à travers le désert. À l’arrière du camion, le garde dans sa veste en velours affiche un sourire rassurant. Dans un anglais approximatif, il me demande si je vais bien, avant de pointer sur sa droite la chaîne de montagnes et de collines au loin.
LÀ-BAS, C’EST L’AFGHANISTAN
Derrière les collines, à moins de cinquante kilomètres de nous, se trouvent les talibans, qui envahissent sans relâche le territoire pakistanais. Nous parlons ensuite de nos familles, des femmes et des enfants. La terreur et la vie quotidienne sont indissociables au Baloutchistan. Les gardes eux-mêmes sont régulièrement victimes d’attentats terroristes. En janvier 2014, six d’entre eux sont morts dans une fusillade alors qu’ils escortaient un cycliste espagnol à travers le Baloutchistan, cinq gardes supplémentaires et l’Espagnol lui-même ont été blessés.
La sérénité et la gentillesse que les gardes ont pour nous ne cessent de m’étonner. Les horreurs qui pourraient nous arriver ici ne nous quittent jamais et pourtant, nos compagnons sont heureux de notre visite et en peu de temps, nous devenons amis sur Facebook.

L’HOSPITALITÉ DANS LE DÉSERT
Pendant deux jours nous traversons le désert en direction de Quetta, la capitale du Baloutchistan. Après la tempête de sable, ce sont maintenant les nuages de pluie qui nous accompagnent. Déjà trois gardes nous attendent dans l’une des huttes. Assis sur une couverture posée sur le sol poussiéreux, ils nous servent du chaï dans de petits verres et partagent leur nourriture avec nous. Saïf, l’un des gardes, nous amène fièrement une salade préparée par ses soins. Concombres, tomates, pois chiches, pommes de terre, oignons… Nous mangeons ensemble dans le même plat jusqu’à ce que le bruit du fond métallique annonce la fin du repas. Nous sommes repus et satisfaits.
Puis Saif sort un téléphone portable. Avec un large sourire, il nous montre des photos de son fils âgé de deux ans et raconte les premières tentatives de parole de sa progéniture. Incroyable : le protecteur brut au regard dur du désert est soudainement devenu un homme de famille doux et amical.
Mais Saïf n’est pas le seul garde qui attire notre attention. Nous sommes aussi escortés par Baba Saïd, dont tout l’être irradie un bonheur irrépressible. À chacun de ses mots il ajoute un sourire chaleureux. Quand nous avons dû nous réfugier dans une petite cabane pour échapper à la pluie, trempés, c’est Baba Saïd qui nous a servi un délicieux chaï tout en nous chantant des chansons d’amour.
Perdus en plein cœur du Baloutchistan, loin de tout ce qui nous était familier, nous nous sommes soudain sentis parfaitement à l’aise. Malgré la présence oppressante des gardes et des armes, Baba Saïd nous a fait oublier un moment la situation difficile dans laquelle nous étions.
Puis, enfin, nous avons fini par atteindre Quetta, d’où nous allions prendre le train pour nous diriger vers le Sud, cette fois escortés par la police pakistanaise. Notre destination : la mégalopole de Karachi.
L'ART ROULANT DU PAKISTAN
Les rois de la route, polis pour briller et incroyablement entretenus, font retentir des centaines de petites cloches et de chaînes à leur passage, et représentent la fierté de la ville.
Karachi est un monstre urbain, une mégapole. Vingt-trois millions de personnes vivent dans cette ville posée au bord de la mer d’Arabie – soit plus d’habitants que sur le continent australien en entier. Karachi est le centre économique et commercial du Pakistan et en même temps, un véritable terrain de jeu pour les artistes et les riches. Pour nous, Karachi est surtout synonyme de liberté. Nous sommes autorisés à nous déplacer sans protection policière pour la première fois de notre voyage au Pakistan ! Pas étonnant donc que cette partie du voyage nous plaise particulièrement !
Karachi a beau être l’une des villes les plus importantes du Pakistan, sa réputation reste franchement modeste. Dès que nous atteignons les limites de la ville en train, nous remarquons les nombreux immeubles délabrés le long des voies. Ne l’oublions pas, Karachi apparaît à plusieurs reprises dans les classements des villes les plus dangereuses du monde. On dit que c’est la ville où il y a le plus d’assassinats à travers la planète. Heureusement, nous n’apprendrons tout cela qu’après avoir quitté Karachi.
Et pourtant, notre séjour à Karachi est tout simplement génial !
Avec des amis, nous partons boire du whisky sur la plage de Bay Hawks. Cette étape nous permet de rencontrer des musiciens, des cinéastes et des journalistes et d’en apprendre chaque jour un peu plus sur le Pakistan. Nous sommes fascinés par la diversité de Karachi – la pauvreté et la violence qui côtoient de près des cafés chics et des grands centres commerciaux dans lesquels la haute société du pays se rencontre régulièrement. Nous avons notamment eu l’occasion de voir une exposition de voitures anciennes en plein cœur de la ville. Difficile de ne pas se laisser surprendre par tant de paradoxes. Dehors, dans les rues de Karachi, la vie est chaotique. Les piétons, les charrettes tirées par des ânes, les chameaux, les motocyclettes, les rickshaws, les voitures et les minibus se pressent dans un décor colonial délabré. Les marchands de légumes ambulatoires rétrécissent les rues déjà surpeuplées. L’air est si pollué par les gaz d’échappement qu’il devient parfois irrespirable. Malgré tout, nous sommes heureux d’être ici. Nous apprécions nous balader, rencontrer des gens, assister au spectacle de la vie locale. Plusieurs fois nous sommes même invités à boire un chaï par des gens qui veulent juste nous parler.

Sans cesse l’appel de la rue triomphe. Partout des camions richement décorés parcourent le centre-ville. Nous ne nous lassons pas de les admirer, parés de leur costume majestueux. Les rois de la route, polis pour briller et incroyablement entretenus, font retentir des centaines de petites cloches et de chaînes à leur passage, et représentent la fierté de la ville. Nous n’avions jamais vu un tel spectacle avant. Ces motifs détaillés, ces couleurs vives, ces décorations superbement sculptées…
Les camions pakistanais sont de loin les plus beaux du monde. Chacun est dédié à une scène artistique à part entière, et a été réalisé par un artiste local.

Nous sommes assis sur une couchette dans une petite salle cimentée, dans une ruelle étroite quelque part dans cette métropole de 23 millions, à siroter tranquillement du chaï. En face de nous, se trouvent Ali et Haider, deux «Truck Artists» dont nous admirons depuis des jours l’art roulant. Haider, âgé de 34 ans, décore les camions depuis l’âge de 8 ans. D’abord en compagnie de son père, et maintenant de manière indépendante, avec une dizaine d’employés. Quand Ali et Haider parlent de leur travail, ils sont en pleine effervescence : le Phool Patti est profondément enraciné dans la culture pakistanaise. C’est la seule forme d’art originaire du Pakistan, elle a son propre style, ses propres modèles et ses propres motifs. Elle transforme des camions quelconques en véritables tapis volants sur roues. Les camions décorés sont des symboles importants de statut social, et une source infinie de fierté pour leurs propriétaires.
Il n’est pas rare que les conducteurs dépensent plus d’argent pour décorer leur véhicule que pour entretenir leur maison et leur famille.
On retrouve sur la plupart des camions des motifs populaires du Pakistan. Les fleurs et les feuilles surdimensionnées jouent un rôle majeur. Immortalisés sur la carrosserie extérieure des camions, l’on retrouve les points de repère de la maison des conducteurs. Les pilotes, explique Haider, veulent montrer d’où ils viennent. La calligraphie et les dessins d’animaux sont également omniprésents. Le tigre du Bengale, comme une expression de force et d’élégance, apparaît très régulièrement. On peut aussi observer sur certains camions des scènes héroïques de la mythologie pakistanaise, avec des héros ressemblant étrangement aux conducteurs.
Ces dessins et motifs ont pour vocation de trouver un soutien spirituel alors que le camion traverse le pays de la mer d’Arabie à l’Himalaya. Religieux, sentimental, émotionnel, régional – tels sont les attributs déterminants du Phool Patti. Mais le Phool Patti, c’est aussi plus que de simples motifs originaux et de couleurs vives. Les camions sont complètement rénovés et reconstruits, affirment Ali et Haider. Ces camions sont un véritable art de vivre ici ! Allez dans n’importe quelle rue de Karachi, frappez aux portes, et vous verrez derrière ces dernières des ouvriers souder, frapper et marteler le métal. C’est un savoir-faire, une passion que beaucoup d’habitants partagent.

Ici, le métal est transformé en long tuyaux d’échappement et les fils sont fraisés.
Karachi est la capitale mondiale du Phool Patti. De partout dans le pays les artistes reçoivent des demandes pour décorer des camions et créer des véhicules spéciaux. Certains conducteurs n’hésitent pas à parcourir plusieurs centaines ou même des milliers de kilomètres pour donner un nouveau look à leur vieux camion.
Il existe autant d’écoles de décorateurs différentes qu’il existe de styles de Phool Patti différents. Karachi et la province de Sindh, dans le sud du Pakistan, sont également célèbres pour travailler les os de chameaux. Les ouvrages en bois du Baloutchistan et de Peshawar dans le nord-ouest sont particulièrement impressionnants. De somptueuses boiseries sculptées ornent d’ailleurs les cabines des conducteurs, et des portes en bois massif remplacent les originales en métal.
Après avoir quitté l’atelier et avoir rencontré Haider et Ali, le Phool Patti reste encore et toujours dans nos mémoires. Dans tout le pays, nous voyons des camions, des minibus et des rickshaws habilement décorés – à Karachi, sur l’autoroute, à Islamabad et sur le chemin de l’Himalaya. Partout nous rencontrons ces incroyables tapis volants sur roues.

G-11/3 ST.110 # 112
Les jumeaux Dizzy : La capitale Islamabad et Rawalpindi, la sœur laide.
Nous atteignons Islamabad après une nuit inconfortable. Escortés par la police, nous changeons de véhicule toutes les 20 minutes. Impossible de dormir. À l’aube, à quelques kilomètres d’Islamabad, notre voiture de police tombe en panne d’essence. Nous nous arrêtons dans la banlieue et, après une tentative de réparation échouée des policiers, ces derniers nous appellent un taxi.
À Islamabad, nous avons l’impression de voyager hors du Pakistan
La circulation chaotique et les routes encombrées qui nous ont accompagné jusqu’ici ont totalement disparu. Les rues sont larges et propres, il y a de nombreux parcs et espaces verts, de la marijuana pousse sur le bord de la route… Les charrettes tirées par des ânes ont disparu. À leur place, nous trouvons des cafés occidentaux, des chaînes de restauration rapide et des restaurants plutôt chics – partout l’influence des diplomates et expatriés qui vivent ici se ressent. Islamabad, c’est en quelques sortes la définition de l’ordre et de la régularité. En 1967, le gouvernement pakistanais décide de remplacer, pour sa capitale, Karachi par Islamabad, une ville pas encore construite mais plus au centre que l’ancienne capitale. La ville est dessinée rapidement, divisée en plusieurs quartiers avec des lignes droites et des angles parfaitement symétriques. Il ne fallut qu’une dizaine d’années pour que la nouvelle capitale voit le jour. Aujourd’hui, les larges avenues de plusieurs kilomètres de long contrastent avec les autres villes pakistanaises. L’autoroute du Cachemire traverse Islamabad en son cœur. Les adresses des habitants sont énigmatiques. Ils vivent dans le G11 / 3 st.110 # 112 ou au F-7/4 st. 28 # 20.
Chaque quartier possède sa propre organisation et vit autour de son marché central où l’on peut aussi bien manger que faire les courses ou aller chez le coiffeur.
Islamabad est en quelques sortes la fierté symétrique du pays.

Il n’y a pas de véritable centre-ville. Si vous voulez sortir, mieux vaut vous rendre dans les quartiers les plus aisés, comme F-7 ou F-6. Le marché de Khosar, par exemple, est un petit marché agréable fréquenté par les expatriés et les Pakistanais aisés. Vous y trouverez de nombreux cafés et des restaurants chics, avec un service de sécurité privé et des caméras de surveillance sur le parking. Les nombreux contrôles permettent de protéger les promeneurs des attaques terroristes. J’ai entendu dire que l’un des pubs du quartier refusait les Pakistanais, mais je ne sais pas si c’est vrai. En tout cas, cet endroit est vraiment étrange et fascinant, avec tous ces diplomates à la peau claire qui dégustent en costume leur frapucchino, alors que plusieurs mendiants sont assis dans la rue à moins de cent mètres de là.

En plus des expatriés que nous rencontrons ici, nous avons également l’occasion de parler à des étudiants, à des graphistes, à des concepteurs de sites web et à des communistes. Un soir, nous nous sommes retrouvés à passer la soirée assis dans un trois-pièces sombre. Au Pakistan, tout est fait pour préserver l’énergie. On ne peut utiliser l’électricité que deux heures à la suite, puis l’alimentation est coupée pendant une heure. Les lumières s’éteignent, les écrans d’ordinateur s’éteignent, le signal Wi-Fi disparaît : il est temps de parler. Avec Murad, médecin à l’Académie militaire, et Muhammad, nous parlons politique. Les deux étudiants, la trentaine à peine entamée, ne mâchent pas leurs mots : le gouvernement est dirigé par l’armée, le pays sombre dans la corruption à tous les niveaux, il n’y a pas d’autorités de surveillance. Et tous les problèmes sont résolus avec l’argent.
Si vous n’avez pas d’argent, vous avez forcément des problèmes.
Inévitablement, nous en venons à parler de l’image du Pakistan à l’étranger, et du terrorisme. Le terrorisme fait depuis longtemps partie de la politique de l’éducation au sein même de l’État. Dans les années 1980, des millions de manuels idéologiques ont été distribués dans tout le pays, prônant le djihad et la guerre sainte. Alors qu’en Allemagne, on distribuait des pommes et des poires aux élèves pour le goûter, les étudiants pakistanais recevaient des bombes et des mitrailleuses. Ils devaient être prêts à combattre et à se déplacer vers l’Union soviétique voisine pour déstabiliser le pays.
Même Murad et Muhammad se souviennent encore des problèmes mathématiques à résoudre à cette époque :
Si votre voisin a 10 bombes et que vous n’en avez que 3 …
Ils se souviennent d’avoir perdu tous leurs espoirs de jeunesse. Le Pakistan n’offre aucun avenir, mais ils ne peuvent pas le quitter. Le passeport pakistanais n’a quasiment aucune valeur dans les autres pays du monde. Ne pas pouvoir quitter le Pakistan semble être la pire punition que l’on puisse leur faire.

Lors du déjeuner, nous rencontrons Kamran, un homme d’affaires d’Islamabad. Ce grand fan de cyclisme et de la VW Beetle nous donne de nombreux conseils de visites à faire à Islamabad. Sur ses conseils, nous décidons de faire une randonnée à travers les collines de Margalla. Situées au nord de la ville, ces collines verdoyantes sont sillonnées par plusieurs sentiers de randonnée et offrent des vues magnifiques sur Islamabad. C’est ici que les habitants passent leurs week-ends, pique-niquent avec leur famille ou font leur jogging. Nous apprécions particulièrement cette petite marche dans la nature jusqu’à ce que deux soldats nous arrêtent sur le chemin. On ne peut pas continuer. Aucune explication. Nous ne sommes pas les bienvenus. Ce n’est pas la première fois que nous sommes arrêtés par les autorités sans raison apparente, toujours au nom de la sécurité. Nous soupçonnons qu’un général ou un politicien déjeune dans un restaurant voisin. C’est en général la raison la plus probable.
Ces interdictions nous sont particulièrement désagréables, surtout à cause de l’attitude générale, et presque arrogante, du personnel de sécurité. Une autre fois, alors que nous sommes assis avec nos sacs à dos sur un banc dans l’un des quartiers les plus riches de la ville, un homme s’approche de nous tout à coup et s’intéresse nos affaires. Face à notre indignation et notre incompréhension, il prétend être un employé de sécurité, malgré l’absence d’uniforme.
Les forces de sécurité et de contrôle sont partout.
Il y a au moins deux gardes de sécurité qui attendent devant chaque café et chaque restaurant pour nous fouiller et nous contrôler avant notre entrée. À chaque fois ils nous répètent que c’est pour notre sécurité, mais nous avons plutôt l’impression d’être des suspects. Certains restaurants étrangers ressemblent à de vraies forteresses. Si vous voulez aller au drive de votre fastfood préféré, par exemple, vous devez faire examiner votre voiture au cas où il y aurait des bombes. Des chiens sont même utilisés lors des fouilles.

C’est dans l’est de la ville que se trouve le quartier diplomatique, où sont réunis toutes les ambassades et tous les consulats, cachés derrière des clôtures de haute sécurité. Il faut passer plusieurs postes de contrôle et subir plusieurs contrôles de sécurité pour les atteindre. Un seul permis est accordé pour chaque visite de consulat ou d’ambassade. Un service de navette emmène les visiteurs à l’ambassade ou au consulat souhaité. Si vous voulez visiter une deuxième ambassade, un deuxième permis doit vous être délivré.
Se balader dans le quartier des ambassades ? Hors de question !
Sur le chemin de l’ambassade de l’Inde, où nous devons demander notre visa pour notre prochain voyage, nous apercevons toute une variété de drapeaux flottant au vent : la Chine, le Koweït, l’Arabie Saoudite, la Finlande… Nous avons même l’occasion de voir le plus grand chantier du moment : sur une surface de la taille de 21 terrains de football, les États-Unis construisent actuellement leur nouvelle ambassade.
Nous croisons un vieux diplomate en T-shirt bleu clair et pantalon vert fluo, faisant son jogging dans la rue, au pas, suivi d’une berline noire aux vitres sombres. Les cafés et les guichets automatiques se succèdent. Les diplomates ont peu de raison de quitter leur quartier de haute sécurité. Il leur est même fortement conseillé de rester ici. Les ambassades canadienne et française ont chacune leur propre bar-club, avec des concerts de musique live et de l’alcool.
Islamabad est une ville confortable, parfaite pour quelques jours de repos. Il n’y a pas grand-chose à y faire à part manger et dormir.
La ville n’a pas grand-chose spécial ni de remarquable. Elle ne restera probablement pas dans nos mémoires bien longtemps. Pour Rawalpindi, c’est une toute autre histoire. Au sud d’Islamabad, Rawalpindi, aussi connue sous le nom de Pindi, est surnommée la « sœur laide de la capitale ». Islamabad et Rawalpindi semblent en effet être jumelées de par leur proximité. Elles sont si proches l’une de l’autre qu’il serait difficile de dire là où une ville commence et l’autre se termine.
À Rawalpindi, il y a beaucoup de poussière, de bruit, de trafic, de klaxons et de véhicules divers se faufilant dans les rues bondées de la ville. On pourrait facilement résumer la cité à ses petites rues sales et à ses maisons délabrées. Les marchands ambulants vendent des fruits et des légumes sur d’énormes chariots en bois improvisés. Des rues entières sont bordées de vendeurs de chaussettes et de fleuristes. Ici, on trouve de tout : des laxatifs aux prothèses dentaires en passant par les vêtements. Les Chai Wallahs, vendeurs de thé, se précipitent d’un côté et de l’autre de la rue pour amener leurs boissons aussi chaudes que possible à leurs clients. La sœur laide, malgré son nom, nous semble bien plus charismatique qu’Islamabad. À Rawalpindi, nous sentons rapidement que le Pakistan est un pays où tout peut arriver, où il n’y a aucune limite.

Au cours de nos flâneries, nous rencontrons Babar, un homme amical, à la moustache épaisse. Babar ne peut pas résister à l’idée nous faire découvrir sa ville comme il la voit – et ce qui s’y trouve dans ses sombres recoins. Jusqu’à récemment, Babar était agent immobilier, rêvant d’histoires de mafia depuis sa plus tendre enfance. Alors que ses copains d’école voulaient être pompier ou policier, Babar n’avait qu’un seul souhait : devenir Le Parrain.
Mais très vite Babar se rend compte que son objectif professionnel ne correspond pas à son caractère. C’est comme ça, ce n’est pas un criminel, juste quelqu’un de sympathique et de passionné. Il se retire donc de la mafia, mais cette dernière lui reste fidèle. Encore aujourd’hui il rencontre toujours des parrains et des chefs de clans. Et nous aussi, en nous baladant avec Babar, nous avons eu l’occasion de nous asseoir à table avec l’un des chefs de la mafia de Rawalpindi.
Connaître des gens haut-placés, c’est important. D’un coup votre tailleur travaille beaucoup plus vite et vous ne payez que moitié prix chez le marchand de fruits.
Mais cette rencontre avec la mafia locale n’est pas notre seule approche du monde underground de Rawalpindi. Plus on passe de temps avec lui et plus on a l’impression que Babar sait tout et connaît tout le monde. Corruption dans les projets de construction ? Là-bas ! Vente illégale de contrebande ? C’est par ici ! Drogues et prostitution ? Deux rues plus loin !
Ici, c’est la mafia qui s’occupe de régler les problèmes de la population. Presque personne au Pakistan ne fait confiance à la police et aux autorités de l’État.

Au cours de l’une de nos promenades, nous nous arrêtons devant d’immenses murs où une foule de gens se presse devant une grille de fer. Des dizaines d’hommes se rassemblent ici, certains en costume, d’autres habillés du shalwar traditionnel Kamiz. Ils portent des colliers de fleurs et des boîtes remplies de sucreries dans leurs mains. Au milieu, se trouvent deux chevaux blancs, brossés et incroyablement bien entretenus.
Nous rejoignons la foule et, quelques secondes après, Babar reçoit également une couronne de fleurs.
Nous sommes sur le point de célébrer publiquement la nomination d’un sénateur. La lourde porte de fer s’ouvre sur une immense propriété. Des jardins de roses, des fontaines, des avenues – et au bout d’une longue allée, une immense villa entourée de colonnes. La musique se met en route, les chevaux commencent à danser et une pluie de confettis s’abat sur la foule. Un homme âgé aux cheveux teints en noir et aux yeux bruns, plusieurs colliers de fleurs autour du cou, salue la foule de la main en regardant de tous les côtés. C’est le nouveau sénateur. Babar nous explique : ceux qui sont nommés sénateurs au Pakistan n’ont, dans la plupart des cas, pas de vraie carrière politique derrière eux. Ils sont ici parce que beaucoup d’argent a coulé pour qu’ils le soient. Il en coûte environ onze millions de dollars pour un poste sénatorial pour le parti au pouvoir (dans l’opposition, bien sûr, c’est un peu moins cher). C’est une somme si énorme que personne ne peut même l’imaginer. Donc, si vous voulez devenir sénateur, il faut chercher des sponsors et ne pas hésiter à chercher l’argent même dans les recoins les plus sombres.
Les célébrations publiques sont moins une fête de bienvenue pour le nouveau sénateur qu’une présentation de ses investisseurs.
Une longue table est installée dans le jardin de la villa. Des boissons et des apéritifs sont servis. Nous observons le terrain avec attention et finissons par trouver l’énorme porte d’entrée de la villa. Le personnel se précipite dedans et dehors, quelques invités se rassemblent dans le hall, puis nous entrons. Soudain, un homme se précipite à l’intérieur, nous propose du Chai et nous envoie avec autorité dans des pièces séparées en fonction de notre sexe. Je me retrouve dans un salon meublé à la manière de Versailles. Des peintures à l’huile pendent au mur, un lustre en cristal rayonne au plafond, d’épais tapis amortissent mes pas et de lourdes tapisseries trônent au milieu de la pièce. C’est calme, mais je ne suis pas seul. Une vingtaine d’hommes sont assis autour de moi, vieux et jeunes, en beaux costumes ou en vestes en cuir. La plupart portent une moustache. Tous ont un même air renfrogné. Je m’installe sur la seule place libre sur un canapé, j’ose un « Salaam » amical et souris timidement dans la ronde.
Aucune réaction – Sauf peut-être quelques grimaces.
Agité, je glisse d’avant en arrière et regarde mon voisin qui porte une veste en cuir et regarde droit devant lui. Je ne me sens pas à ma place et je tente de m’éloigner avant que le chaï promis ne soit servi. Dans la pièce voisine, je vois Babar assis dans un fauteuil couvert de velours doré. Derrière lui, un léopard en peluche est posé sur une table d’appoint, à côté d’une photo de famille. Quand je parle à Babar de l’étrange scène à laquelle je viens de m’échapper, il éclate de rire. Il semblerait que je me sois assis, comme me l’apprend Babar, entre les principaux chefs mafieux de Rawalpindi et les représentants de divers clans. Tous ont soutenu financièrement le nouveau sénateur et attendent maintenant des retours. Le sénateur rejoint ensuite la pièce des hommes puis tout le monde quitte la villa quelques minutes plus tard.

Rawalpindi nous a littéralement coupé le souffle. La saleté de la ville, les rires, les rencontres… Dans quoi nous sommes-nous embarqués ? À un moment donné, il était temps pour nous d’y aller. Sur la route de Karakorum, nous découvrons enfin l’Himalaya.
HINDU SKU, KARAKORUM ET L'HIMALAYA
Région du Nord – Région himalayenne du Pakistan. Le chemin vers le nord, à travers les montagnes, est particulièrement difficile. L’état de la route nous secoue des pieds à la tête.
Le chemin vers le nord, à travers les montagnes, est particulièrement difficile. Les routes étroites, endommagées par les glissements de terrain, et les allées et venues constantes le long de la route sinueuse nous secouent en rythme. Nous atteignons la vitesse record de 40km/h, puis de 50km/h en de rares occasions. Nous sommes sur l’autoroute de Karakorum (KKH), la plus haute autoroute du monde. En-dessous de nous, l’Indus coule vers la mer d’Arabie, et tout autour de nous, s’élèvent des montagnes vertigineuses. Des massifs imposants comme le Nanga Parbat, la montagne tueuse, pointent vers le ciel.
Les trois plus hautes chaînes de montagnes du monde – Hindu Kush, Karakorum et Himalaya – se rencontrent ici.
Avant de pénétrer dans les montagnes, nous traversons une zone dangereuse. À seulement cinquante kilomètres d’Islamabad, nous arrivons à Abbottabad, la ville où, le 2 mai 2011, une unité des forces spéciales américaines a pris d’assaut la propriété d’Oussama ben Laden et abattu le chef de l’organisation terroriste Al-Qaïda après un court échange de tirs. La terreur fut telle que même maintenant, quatre ans plus tard, nos regards se tournent vers les fenêtres, un peu effrayés.
Beaucoup de militaires sont encore présents dans les rues. Plusieurs points de contrôle sont situés le long de l’autoroute. Mais dans la ville elle-même, la vie semble normale. Les étals des marchés, les boutiques et les quelques charrettes à ânes semblent avoir trouvé leur place.
Suivent ensuite trois jours de voyage à travers les montagnes jusqu’à la vallée de la Hunza. Soudain, les montagnes environnantes se dispersent et font place à l’une des vallées les plus pittoresques de tout le continent asiatique. Des centaines d’abricotiers et d’amandiers en fleurs dévoilent toute leur beauté à nos yeux ébahis. Derrière des pics imposants, des massifs aux sommets couverts de neige trônent à plusieurs milliers de mètres d’altitude. La vallée de la Hunza, située au milieu de la route de Karakoram, est considérée comme l’une des plus isolées au monde, entièrement coupée du reste du pays. Parmi les mythes et légendes qui entourent la région, l’on parle d’une longévité étonnante des personnes habitant ici.

La Hunza est surnommée « La vallée des centenaires ». On dit qu’elle est l’un des derniers paradis sur terre.
Nous faisons une pause à Karimabad, ville principale de la vallée de la Hunza. Nous nous asseyons pendant des heures au milieu des arbres fruitiers, admirons le paysage et nous promenons dans les montagnes alentours. Au-dessus de Karimabad, des sentiers étroits de quelques dizaines de centimètres de large permettent de longer les rochers, le long de profonds précipices.
Difficile de retranscrire par des mots toute la beauté de la nature.
Seuls Karimabad et Baltit Fort, un palais royal du XIIIe siècle, se distinguent au cœur des champs verdoyants. Derrière, sur les pentes inférieures de la montagne, une mer de fleurs roses et blanches disparaît lentement pour laisser place aux couleurs brunes et beiges de la roche nue. Au sommet, les pics enneigés et les glaciers rugueux scintillent, dominés par les 7788 mètres de hauteur du Rakaposhi.
Dégustant quelques abricots secs et des mûres, nous nous installons sur un éperon rocheux au bord de la route. Le paradis sur terre nous révèle ses délices culinaires. Ici, les spécialités à base d’abricot sont particulièrement populaires. Les fruits secs, les amandes pilées et l’huile prennent part à quasiment toutes les recettes. Nous avons notamment eu l’occasion de goûter à de savoureux sandwiches farcis de menthe hachée, de coriandre et de fromage, accompagnés d’une délicieuse soupe d’abricot. Le chocolat Hunza, une barre énergétique composée d’abricots secs et de noyaux d’abricot préparée avec du miel et d’autres fruits et noix, fait partie des spécialités locales les plus appréciées.
À Karimabad, nous rencontrons Mumtaz, un jeune professeur d’histoire naturelle de l’école locale. Il ne se passe pas grand-chose ici, dans cette petite ville de 7000 habitants, explique-t-il. Mais ce n’est pas pour autant que ce joueur de cricket s’ennuie. Chaque minute de libre, il la passe avec ses amis à jouer sur le terrain de cricket de la ville. La nouvelle saison d’entraînement commence à peine et tous les jeunes hommes de Karimabad se rassemblent pour essayer de décrocher une place dans l’équipe. Mumtaz, très motivé, balance une raquette imaginaire dans les airs. Le cricket est de loin le sport le plus populaire au Pakistan, pratiqué aussi bien dans les grandes villes que dans les petits villages.

Après le coucher du soleil, Mumtaz nous invite à l’accompagner au casino de la ville. Nous avons peine à y croire : un casino ? Ici ? L’arcade est installée dans le hall d’un hôtel délabré, et plusieurs tables sont disposées dans une salle étroite et allongée. Une lampe à gaz émet une faible lumière autour de laquelle flottent des nuages de fumée provenant d’une dizaine de cigarettes allumées par les joueurs. La pièce est remplie d’hommes, que des hommes. Les voix se mêlent aux rires. Les dés roulent sur les tables, les cartes volent de gauche à droite, les pièces et les jetons claquent sur les plateaux de jeu. Le thé est servi.
Les jeux d’argent sont interdits au Pakistan. Il ne s’agit pas de blackjack ni de roulette, mais plutôt de dames, de petits chevaux et de jeux de l’oie. Tous les jeux de mon enfance sont réunis sur les tables. Avec Mumtaz, j’essaye un jeu de dames mais suis contraint d’abandonner après seulement quelques mouvements seulement. Au Pakistan, le casino, ça ne pardonne pas. Les joueurs sont rapides comme des flèches et chaque erreur est punie sans pitié. Tous les soirs de tous les mois, jusque tard dans la nuit, les habitants se rejoignent ici pour jouer.

SHIMSHAL : UNE RANDONNÉE NON PRÉVUE
Nous quittons Karimabad en empruntant l’autoroute de Karakorum vers le Nord. Mais après seulement quelques dizaines de kilomètres, la route se termine devant un immense lac, le lac Attabad. En 2010, la rivière Hunza s’est retrouvée bloquée par un énorme glissement de terrain, formant un gigantesque réservoir d’eau. Les villages environnants ont été soit complètement, soit partiellement inondés, et les champs ont été détruits. La route vers le Nord est impraticable, elle disparaît sur près de 25 kilomètres, engloutie par l’eau.
Aujourd’hui, l’unique moyen de passer est de naviguer. Des chaloupes traversent le lac et transportent les passagers et les marchandises de l’autre côté. Tout est chargé à la main : de lourds sacs de ciment, des cages remplies de poulets vivants… Une moto a même été installée à l’avant du bateau, maintenue par seulement quelques pierres. La traversée dure environ quarante minutes.
Derrière le lac Attabad, l’autoroute est quasiment vide. Heureusement, nous avons de la chance et trouvons des locaux qui, comme nous, vont à Passu. De là, nous faisons de l’auto-stop pour la vallée de Shimshal, à une cinquantaine de kilomètres de l’autoroute de Karakorum. Mais sur la piste poussiéreuse et le long des virages en épingle à cheveux bordant des parois rocheuses gigantesques, nous ne trouvons personne. Nous marchons donc à travers les gorges étroites, au cœur des montagnes, toujours le long du Shimshal, la rivière du même nom.

Nous errons sur la route, absolument pas préparés à parcourir une telle distance à pied. À part quelques mûres séchées au fond de notre sac, nous n’avons guère de provisions. La cartouche de gaz de notre réchaud de camping est épuisée depuis longtemps. Notre plan a complètement échoué.
Nous marchons seuls sur la route.
Alors que le soleil se couche et qu’il commence à faire froid, toujours aucun véhicule à l’horizon. Nous commençons à ramasser des branches sèches et parvenons à allumer un feu. Nous cuisinons quelques pâtes éparpillées au fond de notre sac puis nous hissons, tremblotants, dans nos sacs de couchage.
Le lendemain matin, nous partons tôt. Nous longeons la rivière à parfois plusieurs mètres au-dessus d’elle. La route, encore et toujours poussiéreuse et pleine de petits cailloux, nous conduit de plus en plus loin à travers les montagnes. Au cœur de ce paysage stérile, seuls quelques amas de cailloux et de rochers viennent briser la monotonie. Au-dessus de nous, les sommets blancs des montagnes brillent sous un ciel bleu.
Toute la journée, nous marchons dans la même direction. De temps en temps, nous traversons un pont et entendons le bruit de la rivière au-dessous de nous. Nos estomacs grognent, le soleil brûle nos visages et pourtant, nous sommes encore loin de Shimshal. Alors que le soleil disparaît une nouvelle fois derrière la chaîne de montagnes, nous nous rendons compte que pas une seule voiture ne nous a dépassé de toute la journée. Petit à petit, nous commençons à nous demander comment nous allons survivre une nouvelle fois à la nuit glaciale. Nous n’avons mangé que quelques pâtes et mûres en 24 heures. Il nous reste deux cents grammes de nouilles instantanées, mais nous échouons à allumer un feu avec les quelques branchages verts trouvés sur le chemin.
Au lieu de faire des flammes, les branchages créent d’épais nuages de fumée, desséchant notre nez et nos yeux.
Alors que nous commencions vraiment à perdre espoir, nous entendons au loin un bruit de moteur. Juste avant que le soleil ne se couche une nouvelle fois, un véhicule en route pour Shimshal passe sur la route et accepte de nous emmener pour les derniers kilomètres.
À Shimshal, la vie est difficile. Pas seulement parce que le chemin pour y accéder est long et ardu, mais aussi parce que le sol est sec et que les nuits sont glacées. Si vous voulez survivre ici, il faut travailler dur. Il n’y a pas d’eau courante, pas de chauffage et pas de réseau électrique en fonctionnement permanent. Ce n’est qu’en été, lorsque le glacier fond, qu’une petite centrale hydroélectrique produit de l’électricité. La vie à Shimshal pourrait se résumer à la gestion des champs et à la collecte laborieuse de l’eau de la rivière. Le bois de chauffage, quant à lui, doit être transporté sur des kilomètres pour rejoindre les habitations. Les agriculteurs conduisent d’énormes troupeaux de moutons, de chèvres et de yaks à travers la vallée jusqu’à leurs pâturages. Ici, le travail, c’est de survivre.

Et pourtant, les habitants de Shimshal sont passionnés par leur région. Ici, presque tout le monde est alpiniste. Il y a même une école d’alpinisme et tous les habitants s’accordent à dire que c’est ici, dans la petite vallée de Shimshal, que les meilleurs alpinistes sont nés et ont grandi.
Lors d’une balade à travers ce petit village de 2000 habitants, un jeune homme, Niamat vient nous parler et nous invite dans la maison de sa famille.
Sa belle-sœur fait cuire du pain sur la plaque métallique d’un four plat. La famille se rassemble autour du foyer. Niamat nous tend un Chai. Sa maison se compose d’une seule pièce.
Sur le mur du fond, une petite armoire de cuisine est fixée, à côté d’un couchage. Le salon est éclairé par un seul trou dans le toit au-dessus du poêle. Il n’y a pas de fenêtres. Des ustensiles de cuisine et quelques livres s’accumulent sur une étagère. De nombreux oreillers et couvertures recouvrent le sol. Ici, la famille mange, dort et vit dans quelques mètres carrés seulement. La petite radio portable, dans le coin, est alimentée par des piles. Les lampes de poche sont quant à elles chargées via un panneau solaire.
Il n’y aura de l’électricité que dans quelques semaines, lorsque les glaciers commenceront à fondre.
Ensemble, nous parlons des conditions de vie difficiles à Shimshal, et de la joie de vivre des habitants de ce coin reculé. Puis, par hasard, nous apprenons que Niamat et son frère cadet, Mansoor, ont contribué à écrire l’Histoire pakistanaise. En 2013, Niamat et Mansoor furent les premiers Pakistanais à mener avec succès une expédition de ski alpin dans leur propre pays. Les deux aventuriers grimpèrent en six heures jusqu’au sommet des 6050 mètres d’altitude du pic de Manglik Sar, pour ensuite rejoindre le camp de base à ski en seulement 17 minutes. Les 5 jours suivants, ils viendront à bout de trois autres sommets de 6000 mètres, laissant de profondes marques dans la poudreuse avec leurs skis. Un record !
Mais Niamat et Mansoor ne sont pas les seuls aventuriers de la ville. Dans un petit restaurant, nous rencontrons Hasil. Lui aussi est alpiniste, et le premier à avoir atteint l’un des plus hauts sommets de la vallée de Shimshal, maintenant appelé le Sunset Peak. En plus d’être alpiniste dans les environs, Hasil participe aussi régulièrement aux expéditions sur le K2 et au Nanga Parbat. Il raconte les ascensions difficiles, parfois même fatales pour ses partenaires, de cette montagne imprévisible et jonchée de cadavres et dès lors que l’on passe une certaine altitude. Il nous raconte de nombreuses anecdotes en riant et nous parle de ses rencontres avec les célèbres alpinistes Hans Kammerlander et Reinhold Messner, qu’il accompagne lors de leurs voyages à travers les montagnes pakistanaises.
Hasil nous parle de Hans le joyeux et de Reinhold le lugubre – un qu’il apprécie, l’autre qu’il n’aime pas.

LE PASSAGE DE LA PLUS HAUTE FRONTIÈRE AU MONDE
Après deux jours d’exploration au cœur de la vallée, d’escalade des glaciers et d’invitations à boire le thé par les paysans rencontrés au hasard de nos balades, nous retournons sur l’autoroute de Karakorum. Pour notre dernière étape vers le Nord, notre objectif est d’atteindre la frontière chinoise. Le Pakistan et la Chine se rencontrent au col de Khunjerab, à près de 4 700 mètres d’altitude. C’est le plus haut passage frontalier fortifié au monde. Mais sur le chemin, une fois n’est pas coutume, nous subissons les effets des glissements de terrain et ne croisons personne, ou presque. Nous parvenons tout de même à atteindre Passu, puis à retourner sur l’autoroute de Karakoram. À Sost, nous rencontrons trois sympathiques ingénieurs en télécommunication. Puis nous nous retrouvons coincés à 24 kilomètres de la frontière. Pas une seule voiture ne vient à notre rencontre. Nous attendons. Equipés d’un carton sur lequel nous écrivons les mots « Chine » et « Khunjerab », nous patientons au bord de la route. Malheureusement, ce carton ne sert à rien, puisqu’il n’y a personne pour le lire sauf un policier qui patrouille dans le coin.
Nous attendons trois jours entiers : du matin jusqu’au soir.
Heure après heure, jour après jour. Seuls les mots encourageants et le Chai du policier nous poussent à continuer à garder espoir.
Le troisième jour, nous n’en pouvons plus et perdons espoir.
Nous hésitons à abandonner et réfléchissons à la suite que nous pouvons donner à notre programme quand Theo et Sereen, deux voyageurs aventuriers de Nouvelle-Zélande et d’Angleterre, passent par là et nous invitent dans leur voiture. Leur destination : le col de Khunjerab. Ensemble nous grimpons en voiture au cœur des montagnes. L’air devient beaucoup plus rare, il fait froid. La neige et la glace commencent à apparaître des deux côtés de la route. Au loin, une marmotte s’amuse dans la neige et des bouquetins grimpent sur des chemins invisibles, en équilibre au bord de parois rocheuses vertigineuses.
Par hasard, nous arrivons au col de Khunjerab en même temps qu’un groupe de touristes chinois. Ces derniers nous prennent pour des Pakistanais et nous demandent de poser avec eux pour des photos souvenirs. Nous tentons d’expliquer que nous ne sommes pas Pakistanais, mais nos paroles se noient dans leur excitation et nous finissons par abdiquer. Amusés, nous passons plusieurs minutes à serrer d’innombrables mains en signe d’amitié sino-pakistanaise et nous sentons comme des ambassadeurs à part entière de notre pays d’accueil.

Puis le groupe disparaît dans un bus et retourne en Chine. Nous revenons également de notre côté, traversons le lac d’Attabad, faisons de l’auto-stop à travers la vallée de Hunza et d’Islamabad, puis prenons le chemin de Lahore, à quelques kilomètres de la frontière indienne.
PRÈS DE L'INDE
Un choc thermique et une cérémonie insolite à la frontière avec l’Inde.
Islamabad et Lahore sont reliés par une route bien entretenue, sur plusieurs voies. Cette route traverse toute une partie du pays et nous permet d’avancer à un bon rythme. L’air conditionné dans la voiture de notre covoiturage est plus que bienvenu. Tandis qu’à l’extérieur, la température monte de minute en minute, nous sommes confortablement assis à l’intérieur et regardons les paysages défiler aux fenêtres.
Mais c’est quand nous arrivons à Lahore, à quelques kilomètres de la frontière indienne, que les choses se gâtent. Car même si soleil a depuis longtemps disparu derrière l’horizon, il fait encore 35°C dehors. Pour nous, qui revenons tout juste d’un séjour à 5000 mètres d’altitude dans les montagnes, le choc est immense. Nous avons l’impression d’être dans un sauna.
Mani et Shareez, deux jeunes étudiants, nous accueillent chez eux. Ils partagent un deux-pièces avec Meero et Hamzar. Au plafond, un ventilateur brasse l’air chaud et agit comme un sèche-cheveux, soufflant constamment de la chaleur dans notre visage.
Mani et Shareez sont adorables. Ils rient sans cesse, plaisantent et, lorsqu’ils s’ennuient, se battent pour s’amuser. Assis en cercle, nous fumons le narguilé, le passe-temps favori de Mani. Quatre à cinq fois par jour, nous remettons du tabac humide dans la tête en céramique de l’appareil, et faisons à nouveau chauffer le charbon sur la plaque de cuisson au gaz de la cuisine.
Lahore n’est pas une étape facile. Il fait chaud, beaucoup trop chaud.
Chaque jour, le mercure atteint les 40°C, et parfois même plus. Nous avons beaucoup de mal à supporter cette chaleur. Dès le matin, elle nous rend littéralement léthargique. Et les choses empirent encore après chaque narguilé. Allongés sur le sol de la salle, nous laissons les deux étudiants nous raconter leur vie. Mani et Shareez admirent notre voyage, notre liberté. Pour eux, c’est tout simplement inconcevable. Partir et laisser la famille derrière ? Cette idée leur semble vraiment extrême. Shareez avoue même qu’il ne peut même pas se rendre de Lahore jusqu’à Islamabad sans demander la permission à son père, ce qu’il lui refuserait probablement, d’ailleurs. D’un geste de la tête, Mani confirme les dires de son ami.
Au Pakistan, les liens familiaux sont très forts. Le père est le chef. Sa parole est loi.
Il n’y a pas beaucoup de place pour la liberté. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles, en traversant le Pakistan, nous devons toujours faire face à des regards curieux et étonnés.
Alors que la chaleur devient une fois de plus étouffante, nous décidons de partir explorer Lahore. Lahore serait l’une des villes les plus indiennes du Pakistan. Pas étonnant, après tout, puisqu’elle n’est située qu’à une trentaine de kilomètres de la frontière indienne et qu’elle est la capitale de l’Etat divisé du Pendjab depuis le désengagement du Pakistan. La ville semble encore un peu plus chaotique que le reste du pays. De tous les côtés, nous sommes regardés avec curiosité. Les passants s’éloignent de nous ou changent carrément de trottoir, juste pour mieux nous regarder.

Lahore possède une histoire longue et mouvementée, visible aujourd’hui à ses nombreux vestiges architecturaux. Ici, les monuments coloniaux de l’époque britannique côtoient d’impressionnantes mosquées, des sanctuaires et des temples. La vieille ville, entourée de hautes murailles centenaires, reste le cœur vibrant de la cité.
Nous passons par la porte de Delhi, l’une des treize entrées du centre historique. Les rues étroites fourmillent de marchands et d’acheteurs, de passants et de badauds. Nous flânons dans les allées des tailleurs, nous baladons au milieu des vendeurs de textiles, dans la ruelle dédiée aux ustensiles d’anniversaire des enfants, puis dans celle consacrée aux épices et aux articles ménagers, et enfin dans celle destinée à l’outillage et aux pièces détachées. Des gens nous suivent, curieux. Nous nous arrêtons, puis ils s’arrêtent, comme paralysés.

La vieille ville de Lahore a toujours été un centre culturel important, un symbole de richesse et de pouvoir. La légende dit qu’elle fut fondée par Loh, fils du dieu hindou Rama, il y a 4000 ans. Les Moghols y ont construit de belles mosquées, des palais et des jardins qui font toujours partie des monuments les plus importants de la ville. Ils ont fait de Lahore l’un des centres islamiques les plus importants du sous-continent. Théologiens, philosophes, poètes et artistes du monde entier sont venus ici, profiter de l’atmosphère mystique de la cité. Plus tard, ce sont les Sikhs qui ont laissé leur marque avant que les Britanniques ne prennent le contrôle. Avec le temps, Lahore est devenu un melting-pot de différentes religions et cultures et est, aujourd’hui, l’un des centres multiculturels les plus importants du pays.
Les habitants sont fiers de la multiculturalité de leur ville. Dans la rue, l’on entend régulièrement chanter « Vive Lahore, vive Lahore » – « Lahore, c’est Lahore ».

Nous entrons dans la forteresse Shahi Qila, site historique classé. Construit par les Moghols, il devait autrefois avoir l’air magnifique. Aujourd’hui, malheureusement, la région est trop pauvre pour la restaurer. La peinture se décolle des murs, les déchets s’accumulent dans tous les recoins, des incendies ont régulièrement lieu dans la bâtisse… Seule la massive Porte Alamgiri, de par sa taille et sa beauté, laisse supposer le prestige passé de la forteresse.

Juste à côté de la forteresse, se trouve la mosquée Bashahi, autrefois plus grande mosquée du monde. En entrant dans l’immense cour, nous nous brûlons littéralement les pieds sur les dalles de pierre. Seule une bande de tapis en caoutchouc épais permet de pénétrer à l’intérieur.
Rapidement, nous retournons à l’appartement de Mani, où une délicieuse glace et un narguilé nous attendent.
CÉRÉMONIE INSOLITE À LA FRONTIÈRE INDIENNE
Nous sommes seulement à quelques kilomètres de la frontière indienne. Depuis l’indépendance, des tensions politiques ont surgi entre les puissances nucléaires du Pakistan et de l’Inde. À la frontière Wagah-Attari, cette animosité politique s’exprime à travers une cérémonie plutôt inédite : la cérémonie de fermeture de la frontière. Chaque soir, c’est un véritable cirque qui est organisé ici.
Le plus divertissant de tous les défilés militaires !
Des soldats en uniforme, décorés de drôles de chapeaux, aux barbes soigneusement taillées, défilent en contrebas. Déterminés, ils montrent leur force aux autorités frontalières du pays voisin. Exagéré et synchronisé dans les moindres détails des deux côtés, le spectacle mérite le détour. Les soldats ne se contentent pas de marcher, ils se battent les uns avec les autres. Leur arme ultime : le high-kick, ou coup de pied circulaire. Ils lancent leur jambe au-dessus de la tête de leur adversaire et frappent leur front avec leur genou. Les poings serrés et les gestes contenus, les soldats continuent ensuite leur défilé, comme des robots. Les Monty Python n’auraient pas fait mieux !
Comme si ce cirque ne suffisait pas, il y a des centaines, voire des milliers de spectateurs des deux côtés de la frontière. Les animateurs, dans leur tenue et équipés d’un drapeau, donnent le ton, motivant leurs compatriotes à faire le plus de bruit possible pour « montrer » qui a le plus de soutien à l’adversaire. Assourdissants, des « Pakistan Zindabad » – « Vive le Pakistan » sont criés dans les airs et suivis par une réponse quasi immédiate : « Hindustan Zindabad » – « Vive l’Inde ». Les poings sont balancés au-dessus des têtes, les spectateurs, patriotes, bondissent de leur siège et se mettent à sauter dans tous les sens. Difficile de dire si l’ambiance est celle d’un festival ou d’un match de foot. Mais cela n’a aucune importance, puisque l’on ressort immanquablement de cette cérémonie complètement sourd !

Après une heure de cris et de menaces, le spectacle se termine et la frontière se ferme. Lentement et uniformément, les drapeaux nationaux sont rangés des deux côtés. Malheur si l’un des deux drapeaux reste plus longtemps que l’autre ! Enfin, un officier pakistanais et un officier indien se serrent la main brièvement, énergiquement et probablement douloureusement.
À la fin, les deux portes des frontières sont fermées à clés. La cérémonie est terminée.
Des deux côtés, il est temps de prendre des photos souvenirs avec les soldats. Si un Pakistanais ou un Indien regardait de l’autre côté de la frontière, il aurait l’impression de se reconnaître, et l’aversion qui sépare politiquement les deux nations perdrait un peu de sa ferveur.
Des deux côtés, ce sont les mêmes personnes qui vivent, la même mentalité qui est partagée, la même langue qui est parlée, le punjabi. Mais au lieu de se regarder, tous préfèrent acheter des souvenirs : des tapis de souris ou des mugs avec des photos des soldats, des DVD des cérémonies… Et demain, le cirque recommencera.
Demain nous serons en Inde.
Merci à Morten et Rochssare d’avoir partagé leur aventure
 En 2011, Morten et Rochssare sont partis vivre sur le continent sud-américain. Pendant deux ans, ils ont voyagé entre la Terre de Feu et les Caraïbes, se déplaçant en auto-stop et se logeant grâce au couchsurfing.
En 2011, Morten et Rochssare sont partis vivre sur le continent sud-américain. Pendant deux ans, ils ont voyagé entre la Terre de Feu et les Caraïbes, se déplaçant en auto-stop et se logeant grâce au couchsurfing.
Depuis 2014, les deux auto-stoppeurs allemands visitent l’Inde et maintenant l’Asie du Sud-Est. Ils sont actuellement à Bangkok et nous parlent de leurs aventures et de leurs rencontres sur leur blog mortenundrochssare.de et dans leurs deux livres « Hitchhiking through South America » et « Hitchhiking to India », chacun publié par la maison d’édition Piper dans la série National Geographic. Des nouvelles de leur voyage sont disponibles sur leur page Facebook et sur Instagram.
Si tu souhaites recevoir des notifications quand les prochaines Story paraîtront, inscris simplement ton email.